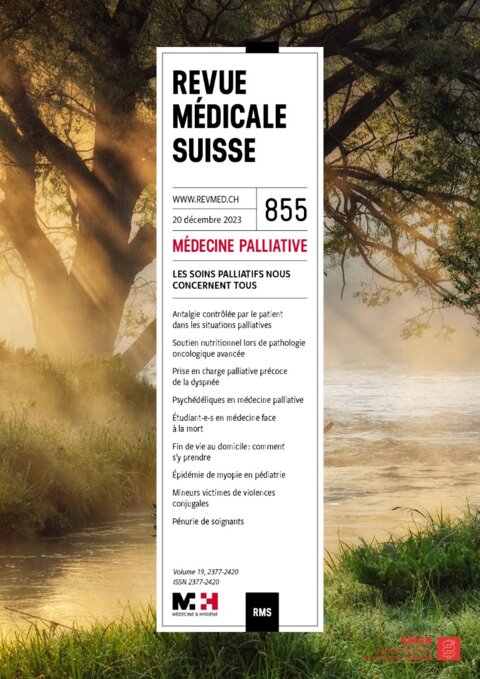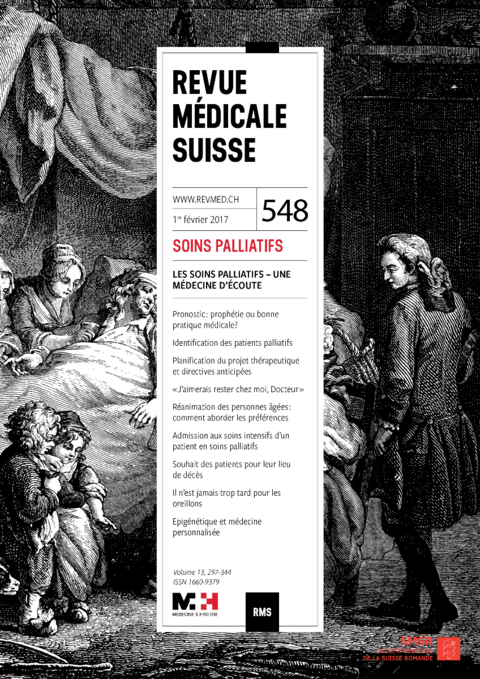La plus grande peur de tout être humain, même de celui qui a choisi de vivre en ermite, n’est pas de mourir. C’est de mourir seul. D. Carrisi
Lorsque j’étais jeune assistant, j’ai vécu l’expérience de mourants laissés seuls par l’équipe soignante dans une chambre isolée. Une telle relégation était justifiée – me disait-on – par la volonté d’épargner les voisins de grandes chambrées du spectacle de l’agonie. À l’époque, j’avais tout de même le sentiment d’une carence d’humanité liée à l’état d’abandon que la personne en fin de vie devait nécessairement éprouver. Un demi-siècle a passé depuis mes débuts en médecine et je dois dire que la situation a beaucoup changé.
Les soins palliatifs, l’attention à la qualité de la fin de la vie ont permis aux personnes âgées et aux malades, le plus souvent, de mourir entourés par leurs proches ou, à défaut, par des soignants attentifs. Mais la question pourrait se poser différemment aux soins intensifs. Le Covid-19 a changé la donne.
Dans les conditions d’urgence, de surmenage menaçant en cette période de pandémie, les malades risquent de mourir sans un moment d’adieu de la part de leurs proches, et ces derniers, de rester seuls dans leur douleur. Heureusement, il y a des exceptions ! Le 20 mars, au téléjournal de la RTS, un reportage montrait des réanimateurs discuter par portable avec la fille d’une patiente dans des conditions graves ; les soignants ont ensuite filmé la patiente, intubée et en sédation. Cela m’est apparu comme un acte d’humanité qui a permis un ultime geste de piété filiale. J’en étais profondément touché.
À la toute fin de la vie, l’état de conscience est fortement altéré ; en réanimation, la désafférentation est médicalement induite. Mais l’humain – conscient ou pas – n’affronte-t-il pas mieux l’épreuve si quelqu’un lui tient la main ? Ou bien, au moment du trépas, est-on forcément seul ? Les proches ne peuvent entrer dans les salles de réanimation, ni de toute façon accompagner leur malade au-delà du passage redouté.
J’ai vu des reportages en Italie, et notamment un où un malade, partiellement conscient, criait pendant la nuit pour demander que quelqu’un vienne le soulager ou simplement mettre une main sur son épaule en lui disant : mon frère, je suis là.
Si l’expérience de la mort, si difficile à traverser, concerne en premier lieu l’individu en fin de vie, elle n’épargne pas l’entourage, qu’il soit présent ou pas. Nous mourons aux autres. L’homme, par nature, ne vit pas seul. Par notre propre mort, nous interrompons ce lien essentiel aux autres qui fait de notre vie une expérience unique et riche. Le lien, par définition limité par la fin de la vie biologique, mérite un soin humain, une prise de congé, un rituel. Pour Philippe Ariès, la bonne mort est celle qui consiste à être entouré des siens dans un sentiment de pacification et dans un adieu quelque peu ritualisé. Mais cette ritualité a été bannie par l’épidémie. Enterrement express, cortège funèbre restreint et bref, pas de consolation sociale.
Pour la première fois, dans cette conjoncture, je me sens appartenir de plein fouet à la classe grandissante des personnes âgées, donc à une catégorie à risque… d’être délaissée. Comme le dit – avec finesse mais non sans une certaine ambiguïté – la récente recommandation de l’ASSM, par rapport aux limites potentielles de nos dispositifs de santé : L’âge est indirectement pris en compte dans le cadre du critère « pronostic à court terme », car, dans le contexte du Covid-19, (…) il constitue un facteur de risque de mortalité. Laisser les vieux mourir, parce qu’ils vont de toute façon mourir, soit, quoique. Mais seuls ? Un mort qu’on abandonne est mort deux fois.