JE M'ABONNE DÈS AUJOURD'HUI
et j'accède à plus de contenu
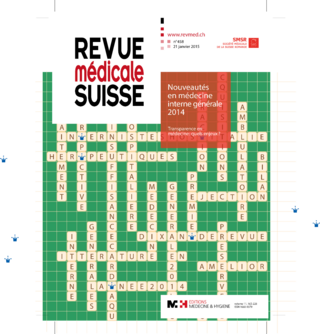
La Revue Médicale Suisse, c'est 43 numéros par an et l'accès à de nombreux autres contenus en ligne (colloques, livres,...). La RMS s'adresse aux médecins de premier recours, mais aussi aux spécialistes des diverses disciplines médicales, aux médecins assistants et chefs de clinique, aux étudiants et aux autres professionnels de la santé, soit à la communauté médicale francophone dans son ensemble.
*Vous êtes étudiant.e.s ? Vous pouvez bénéficier d'un tarif spécial pour accéder au site de la Revue Médicale Suisse. Pour tout abonnement étudiants 100% numérique souscrit, un justificatif sera demandé (vous recevrez un email après votre commande).
Contactez notre service abonnement afin d'obtenir une offre sur mesure :
Par email ou par téléphone au +41 22702 93 11
Vous pouvez bénéficier d'un tarif spécial pour accéder au site de la Revue Médicale Suisse. Pour tout abonnement étudiants 100% numérique souscrit, un justificatif sera demandé (vous recevrez un email après votre commande).
| Titre | REVUE MÉDICALE SUISSE 458 |
|---|---|
| Éditeur | Médecine et Hygiène |
| Thème | Médecine interne générale |
| Type | Revues |
| ISSN | 1660-9379 |
| Durée | 12 mois |
Revue médicale suisse
Médecine et Hygiène
Chemin de la Mousse 46
1225 Chêne-Bourg
Suisse
Rédacteur en chef | |
Bertrand Kiefer | |
Tél. |
+41 22 702 93 36 |
E-mail: |
|
|
|
Rédacteur en chef adjoint et responsable des opérations | |
Pierre-Alain Plan | |
E-mail: |
|
|
|
Secrétariat de rédaction / édition | |
Chantal Lavanchy | |
Tél. |
+41 22 702 93 20 |
E-mail: |
|
|
|
Joanna Szymanski | |
Tél. |
+41 22 702 93 37 |
E-mail: |
|
|
|
Comité de rédaction
Dr B. Kiefer, rédacteur en chef ; Dr G. de Torrenté de la Jara, Pr A. Pécoud, Dr P.-A. Plan, rédacteurs en chef adjoints ; M. Balavoine, rédacteur.
Secrétaire de rédaction
Chantal Lavanchy : chantal.lavanchy@medhyg.ch
Conseil de rédaction
Dr M. S. Aapro, Genolier (Oncologie) ; Pr A.-F. Allaz, Genève (Douleur) ; Dr S. Anchisi, Sion (Médecine interne générale) ; Pr J.-M. Aubry, Genève (Psychiatrie) ; Pr C. Barazzone-Argiroffo, Genève (Pédiatrie) ; Pr J. Besson, Lausanne (Médecine des addictions) ; Pr F. Bianchi-Demicheli, Genève (Médecine sexuelle) ; Pr T. Bischoff, Lausanne (Médecine interne générale) ; Pr W.-H. Boehncke, Genève (Dermatologie) ; Pr. G. Bondolfi, Genève (Psychiatrie de liaison) ; Pr G.-D. Borasio, Lausanne (Soins palliatifs) ; Pr H. Bounameaux, Genève (Angiologie) ; Pr T. Buclin, Lausanne (Pharmacologie clinique) ; Pr C. Büla, Epalinges (Gérontologie) ; Pr P. Burkhard, Genève (Neurologie) ; Pr B. Burnand, Lausanne (Médecine sociale et préventive) ; Pr M. Burnier, Lausanne (Néphrologie) ; Pr T. Calandra, Lausanne (Maladies infectieuses) ; Dr A. Calmy, Genève (Maladies infectieuses, sida) ; Pr P.-N. Carron, Lausanne (Médecine d’urgence) ; Pr F. Chappuis, Genève (Médecine des voyages) ; Pr C. Chuard, Fribourg (Maladies infectieuses) ; Pr P. Conus, Lausanne (Psychiatrie) ; Pr J. Cornuz, Lausanne (Médecine de premier recours) ; Pr G. Coukos, Lausanne (Oncologie) ; Pr J.-B. Daeppen, Lausanne (Médecine des addictions) ; Pr J.-F. Delaloye, Lausanne (Gynécologie-obstétrique) ; Pr N. Demartines, Lausanne (Chirurgie) ; Pr J. Desmeules, Genève (Pharmacologie clinique) ; Pr P.-Y. Dietrich, Genève (Oncologie) ; Pr R. Du Pasquier, Lausanne (Neurologie) ; Pr A. Farron, Lausanne (Orthopédie) ; Pr S. Ferrari, Genève (Maladies osseuses) ; Pr P. Fontana, Genève (Angiologie) ; Pr R. Frackowiak, Lausanne (Neurologie) ; Dr J.-G. Frey, Montana (Pneumologie) ; Pr J.-L. Frossard, Genève (Gastro-entérologie) ; Pr C. Gabay, Genève (Rhumatologie) ; Pr P. Gasche Soccal, Genève (Pneumologie) ; Pr J.-M. Gaspoz, Genève (Médecine interne générale) ; Pr J. Gasser, Lausanne (Psychiatrie) ; Pr A. Geissbühler, Genève (Cybersanté et télémédecine) ; Pr D. Genné, Bienne (Maladies infectieuses) ; Pr B. Genton, Lausanne (Médecine des voyages) ; Pr M. Gilliet, Lausanne (Dermatologie) ; Pr A. Golay, Genève (Diabétologie) ; Pr G. Gold, Genève (Gériatrie) ; Pr S. Grabherr, Lausanne (Médecine légale) ; Dr G. Gremion, Lausanne (Médecine du sport) ; Pr G. Greub, Lausanne (Microbiologie clinique) ; Pr I. Guessous, Genève (Médecine ambulatoire) ; Pr J.-P. Guyot, Genève (ORL) ; Pr D. Hayoz, Fribourg (Angiologie) ; Pr D. Hannouche, Genève (Orthopédie) ; Pr M. Hofer, Lausanne (Pédiatrie) ; Pr P. Hoffmeyer, Genève (Orthopédie) ; Pr T. Hügle, Lausanne (Rhumatologie) ; Pr O. Irion, Genève (Gynécologie-obstétrique) ; Pr C. Iselin, Genève (Urologie) ; Pr P. Jichlinski, Lausanne (Urologie) ; Pr P. Jolliet, Lausanne (Médecine intensive) ; Dr F. Jornayvaz, Lausanne (Diabétologie) ; Pr L. Kaiser, Genève (Maladies infectieuses) ; Dr O. Kherad, Meyrin (Médecine interne générale) ; Pr A. Kleinschmidt, Genève (Neurologie) ; Pr O. Lamy, Lausanne (Maladies osseuses) ; Pr C. Lovis, Genève (Sciences de l’information) ; Pr F. Mach, Genève (Cardiologie) ; Pr F. Marchal, Genève, (ORL) ; Pr P. Mathevet, Genève (Gynécologie-obstétrique) ; Pr P.-Y. Martin, Genève (Néphrologie) ; Pr B. Martinez de Tejada Weber, Genève (Gynécologie-obstétrique) ; Pr L. Mazzolai, Lausanne (Angiologie) ; Pr C. Meier, Zurich (Médecine interne) ; Pr J. Menetrey, Genève (Médecine du sport) ; Pr P.-A. Michaud, Lausanne (Médecine de l’adolescence) ; Pr P. Michetti, Lausanne (Gastroentérologie) ; Pr D. Moradpour, Lausanne (Gastroentérologie) ; Pr P. Morel, Genève (Chirurgie) ; Pr O. Muller, Lausanne (Cardiologie) ; Dr F. Narring, Genève (Médecine de l’adolescence) ; Pr L. Nicod, Lausanne (Pneumologie) ; Pr F. Paccaud, Lausanne (Médecine sociale et préventive) ; Pr A. Pechère-Bertschi, Genève (Hypertension) ; Pr A. Perrier, Genève (Médecine interne générale) ; Pr S. Peters, Lausanne (Oncologie) ; Pr P. Petignat, Genève (Gynécologie) ; Pr J. Philippe, Genève (Diabétologie) ; Pr C. Pichard, Genève (Nutrition) ; Dr V. Piguet, Genève (Douleur) ; Pr D. Pittet, Genève (Maladies infectieuses) ; Dr F. Pralong, Meyrin (Endocrinologie) ; Dr G. Praz, Sion (Maladies infectieuses) ; Pr J. Prior, Lausanne (Médecine nucléaire) ; Pr J.-L. Reny, Genève (Médecine interne générale) ; Pr M. Righini, Genève (Angiologie) ; Pr. H.-B. Ris, Lausanne (Chirurgie) ; Pr R. Rizzoli, Genève (Ostéoporose) ; Pr N. Rodondi, Berne (Médecine interne générale) ; Pr L. Rubbia-Brandt, Genève (Pathologie clinique) ; Pr F. Sarasin, Genève (Médecine d’urgence) ; Pr A. Scheen, Liège (Thérapeutique) ; Pr J. Schrenzel, Genève (Microbiologie clinique) ; Pr V. Schwitzgebel, Genève (pédiatrie) ; Pr J. Seebach, Genève (Allergo-immunologie) ; Pr N. Senn, Lausanne, (Médecine de famille) ; Pr P. Senn, Genève (ORL) ; Pr C.-A. Siegrist, Genève (Vaccinologie) ; Pr C. Simon, Lausanne (ORL) ; Pr J. Sommer, Genève (Médecine de famille) ; Pr F. Spertini, Lausanne (Allergo-immunologie) ; Pr F. Stiefel, Lausanne (Psychiatrie de liaison) ; Pr A. Superti-Furga, Lausanne (Pédiatrie) ; Dr M. Suter, Genève (Douleur) ; Dr J. Sztajzel, Genève (Cardiologie) ; Dr R. Sztajzel, Genève (Neurologie) ; Pr J.-D. Tissot, Lausanne (Hématologie) ; Pr F. Triponez, Genève (Chirurgie) ; Pr N. Troillet, Sion (Maladies infectieuses) ; Pr P. Urban, Meyrin (Cardiologie) ; Dr J. Villard, Genève (Allergo-immunologie) ; Pr F. Vingerhoets, Lausanne (Neurologie) ; Dr P. Vogt, Lausanne (Cardiologie) ; Pr P. Vollenweider, Lausanne (Médecine interne générale) ; Pr G. Waeber, Lausanne (Médecine interne) ; Dr G. Wuerzner, Lausanne (Hypertension, néphrologie) ; Pr B. Yersin, Lausanne (Médecine d’urgence) ; Dr G. Zulian, Collonge-Bellerive (Soins palliatifs)
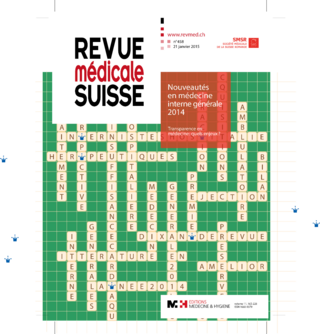
Le produit a bien été ajouté au panier ! Vous pouvez continuer votre visite ou accéder au panier pour finaliser votre commande.
Veuillez entrer votre adresse email ci-dessous pour recevoir un lien de réinitialisation de mot de passe
Vous pouvez créer votre nouveau mot de passe ici
Certains de ces cookies sont essentiels, tandis que d'autres nous aident à améliorer votre expérience en vous fournissant des informations sur la manière dont le site est utilisé.
Les cookies nécessaires activent la fonctionnalité principale. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.
Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site de la Revue Médicale Suisse afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. En désactivant ces cookies, nous ne pourrons pas analyser le trafic du site de la Revue Médicale Suisse
Ces cookies permettent à la Revue Médicale Suisse ou à ses partenaires de vous présenter les publicités les plus pertinentes et les plus adaptées à vos centres d’intérêt en fonction de votre navigation sur le site. En désactivant ces cookies, des publicités sans lien avec vos centres d’intérêt supposés vous seront proposées sur le site.
Ces cookies permettent d’interagir depuis le site de la Revue Médicale Suisse avec les modules sociaux et de partager les contenus du site avec d’autres personnes ou de les informer de votre consultation, lorsque vous cliquez sur les fonctionnalités de partage de Facebook et de Twitter, par exemple. En désactivant ces cookies, vous ne pourrez plus partager les articles de la Revue Médicale Suisse depuis le site de la Revue Médicale Suisse sur les réseaux sociaux.

